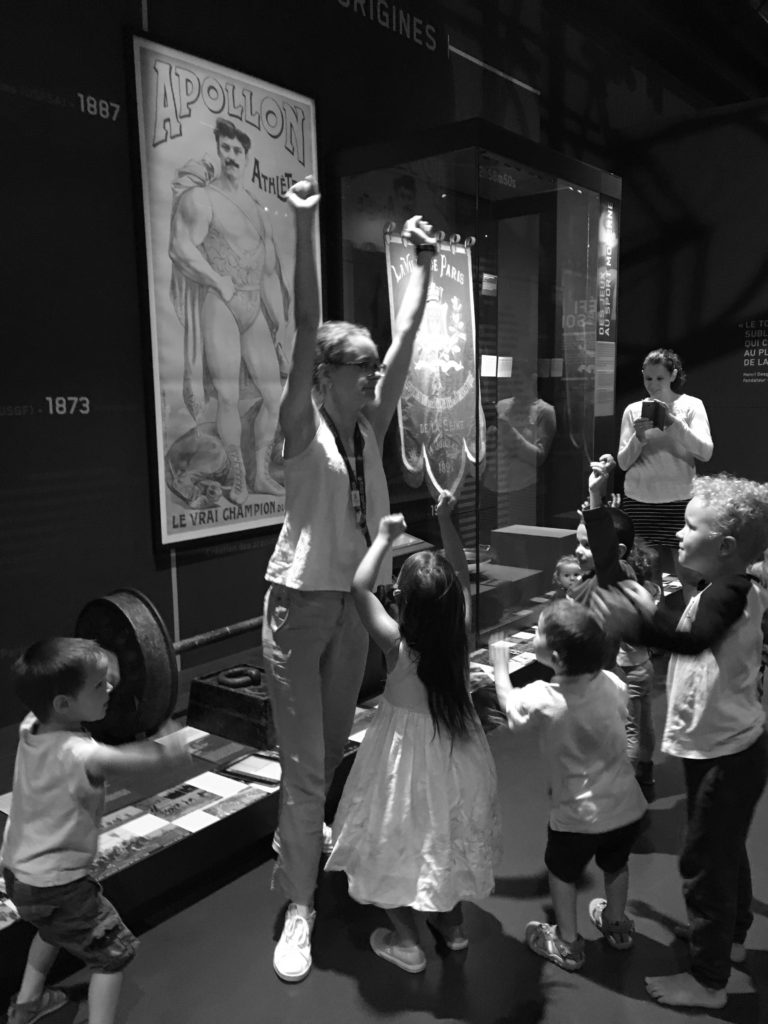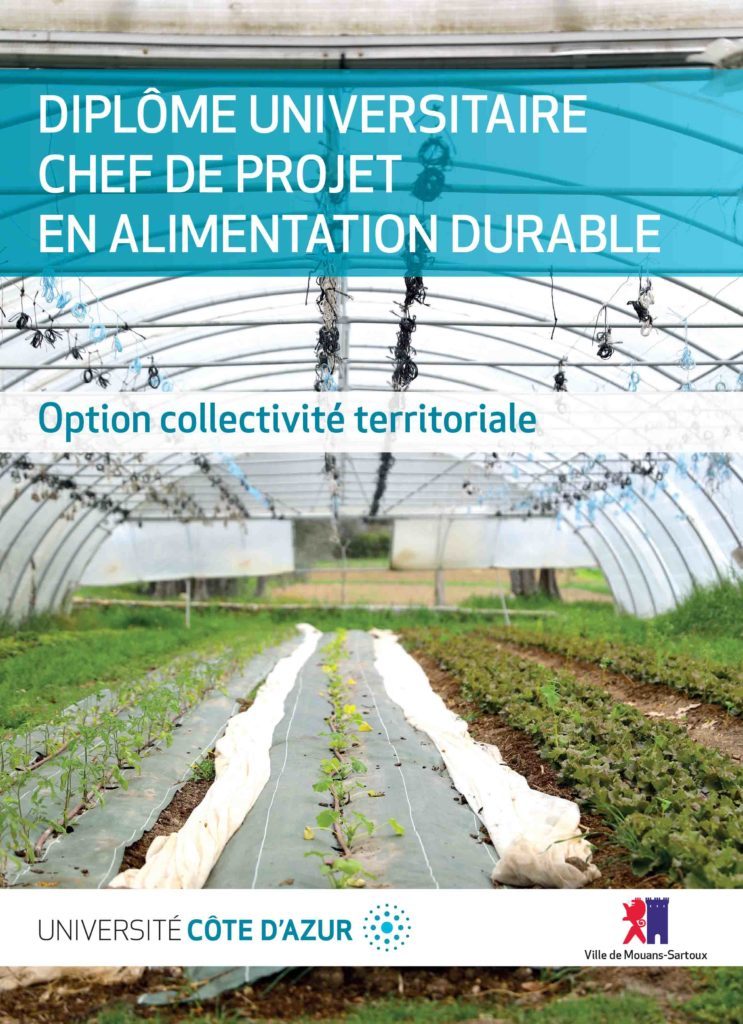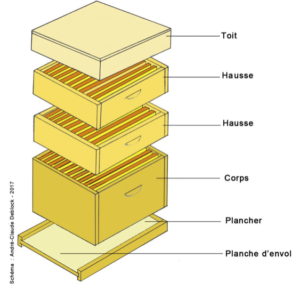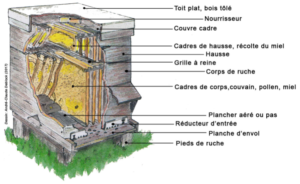Par Magali Braconnot, membre du Conseil de Fonctionnement de l’école
1• Nature, genèse et contexte
Novembre 2014, Marseille 3ème arrondissement (quartier socio-économiquement très défavorisé). Des parents et un enseignant luttent depuis plusieurs années à l’intérieur de l’Éducation Nationale (école primaire) pour développer une pédagogie émancipatrice de type Freinet dans sa version pédagogie sociale (*). L’enseignant est actif dans le mouvement des « enseignants désobéisseurs » contre les évaluations et les fichiers élèves.
L’usure psychologique crée la rupture, l’enseignant démissionne. S’ouvre alors la possibilité de création d’un autre espace éducatif, porté conjointement par l’enseignant et des parents, accompagnés par des soutiens militants.
(*) références pédagogie sociale : Laurent Ott, Radlinska, école du 3ème type de Bernard Collot.
2• La taille de l’école

Le local : un 3 pièces rez-de-jardin (44m2) dans un parc avec jardin partagé + un atelier partagé
L’encadrement et le public : 2 éducateurs, 20 enfants de 4 à 10 ans
Le matériel : mobilier, consommable de récupération
Les postes principaux de dépenses : loyer, Salaires (2 postes), hygiène sanitaire, peinture, colle, photocopies, site, communication, électricité.
3• Paramètres économiques et financiers
Pour être au plus proche du projet social revendiqué, une faible participation de 30 euros par mois est demandée aux familles, qui couvrent le loyer, les frais administratifs, l’électricité, etc. Il y a donc nécessité de trouver un financement autre (mécénat, événements divers, dons réguliers et ponctuels). Après 3 ans, les rentrées d’argent sont insuffisantes, la participation passe à 50€ par mois.
Le lieu d’accueil est peu onéreux (300€/ mois), ce sont les 2 salaires d’éducateurs (35h et 26h au smic) qui constituent le poste principal du budget (36 000 euros annuel).
Les frais de fournitures en matériel fongible et équipement relèvent d’une démarche de récupération et d’apports personnels.
Les financements publics par subvention sont difficiles à obtenir en tant qu’école. Le projet ne rentre pas dans les cases habituelles de financement soit du scolaire, soit du péri/extra scolaire.
Le mécénat : du coté des fondations, le financement ne peut pas être pérenne et ne règle pas la problématique de masse salariale annuelle (finance des projets et non du fonctionnement). Il ajoute un temps de travail important de montage de dossier. L’équilibre économique reste précaire dans ces conditions.
4• Paramètres juridiques
Le modèle juridique souhaité à l’origine correspond à celui d’une SCOP (le pouvoir aux travailleurs), mais la volonté d’en faire un service public hors État (le financement ne repose pas sur les usagers) impose une forme associative, loi 1901.
Le projet d’espaces éducatifs n’a pas pour but de créer une école au sens habituel. En 2015, le cadre légal impose de faire une déclaration de création d’école, pour accueillir des enfants toute la journée. Les contrôles effectués concernent l’hygiène, la santé sanitaire, les bonnes mœurs (sic), le socle des connaissances.
La loi change au printemps 2018 : la déclaration s’effectue auprès du Rectorat donc de l’État. D’autre part, une déclaration de lieu d’accueil pour mineurs sans hébergement extra-scolaire n’est pas acceptée par la jeunesse et sport, car les locaux ne correspondent pas aux normes requises.
5• Mode de gouvernance
La première année de gouvernance s’appuie sur les porteurs initiaux du projet et une grande ouverture aux personnes volontaires pour participer aux décisions lors des réunions appelées « Agora ». La réactivité décisionnelle et l’indépendance des éducateurs posent alors question.
Une deuxième étape (année 2 et 3) restreint les décisions à un conseil de fonctionnement de 5 personnes. Cooptées, elles travaillent bien ensemble et se font confiance pour prendre des décisions de manière rapide, et éviter de se perdre dans les tensions humaines inévitables. Le bureau collégial est réduit à trois personnes.
Le statut de parent n’est pas prépondérant. C’est l’engagement politique et une certaine distance affective qui permet de former ce collectif décisionnaire. L’Agora devient uniquement informative et consultative.
Une troisième étape (fin de l’année 3) crée 3 collèges : parents, travailleurs, garants. Le Conseil de Fonctionnement est constitué de leurs représentants élus. L’objectif est de protéger les travailleurs et le sens du projet par une relation coopérative entre les membres du Conseil. L’Agora est constituée des membres des collèges.
6• L’évolution du projet :
Le choix est fait de commencer à construire sans attendre que toutes les conditions soient réunies, pour mettre en œuvre réellement le tâtonnement expérimental.
Six mois pour : créer une association, écrire un projet social et éducatif, diffuser l’information, trouver un local et un financement. Un an pour tester la vie éducative avec 10 enfants et réajuster la structure associative.
Une deuxième année pour investir des locaux plus vastes avec 19 enfants, renforcer le lien avec l’environnement humain de proximité et rédiger de nouveaux statuts.
Enfin, une troisième année pour agrandir le local, créer un événement mensuel à vocation sociale, éducative et économique, s’ancrer dans l’environnement et stabiliser la gouvernance associative.
7• Paramètres humains, constats, réflexions et perspectives :
Au-delà d’une école il s’agit d’espaces éducatifs : éducation les uns par les autres, un projet ancré dans un quartier (projet social et écolo politique)

Le projet est difficile à tenir humainement pour assurer à la fois la recherche de financement, la partie pédagogique, l’ensemble des projets périphériques (jardin…) et la vie de l’association (administration, coordination, en plus du scolaire). Le temps en présence des enfants est important, il faut tenir compte aussi du besoin en temps de préparation, de recul et de réflexion.
La surcharge de travail est importante, les domaines de compétence sont vastes et concernent souvent les mêmes personnes : éducatif, gestion, administration, animation, projet politique, psychologie, sociologie, recherche de financement, entretien …
Pour maintenir l’accès à faible coût pour les familles, il faut développer des activités, en plus de celles éducatives.
Le travail se fait souvent dans l’urgence, sur des temps courts et quotidiens.
Mais les travailleurs doivent avant tout être des éducateurs (être en relation éducative avec enfants et adultes) avec une spécialité : enseignant, jardinier, animateur, rédacteur de projets, gestionnaire…).
Les définitions juridiques aident à construire les rapports humains mais le vécu est souvent plus complexe (rapports humains en jeux, leadership etc…). Cela nécessite de prendre du temps de concertation entre l’ensemble des auteurs : travailleurs rémunérés, travailleurs bénévoles du conseil de fonctionnement, parents, bénévoles engagés dans des actions de soutien, etc.
Les tensions humaines sont aussi accentuées par un équilibre économique fragile. Être sous contrat avec l’État permettrait de soulager cet aspect. Mais il existe un risque de tension d’une autre nature, plus politique, concernant les libertés d’éducation et de pratiques pédagogiques.
http://www.vieasso.bricabracs.org/
Contact: lesbricabracs(à)bricabracs.org