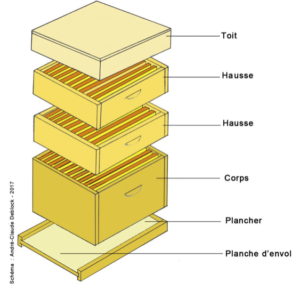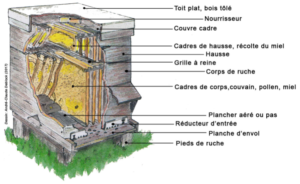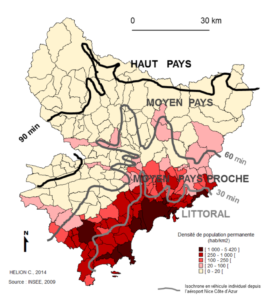Genèse
L’Epicerie Boomerang a été créée à Mouans Sartoux début 2016 par Laura Giacco et Thomas Franchi, diplômés en management et marketing.

Après avoir vécu des expériences professionnelles qui leur sont apparues en décalage avec leurs valeurs, Laura et Thomas ont eu la volonté d’agir de manière positive pour un nouveau mode de fonctionnement économique. Nourris par leur implication dans des associations – Colibris, projet cueillette solidaire – ils ont suivi la formation bio de la Ferme Sainte Marthe, puis se sont lancés dans un projet d’épicerie en vrac, bio et local.
Le concept de l’épicerie est de proposer un lieu convivial où l’on trouve tous les produits alimentaires et non alimentaires du quotidien en vrac et donc sans emballage à usage unique. L’objectif est de proposer des produits de qualité, si possible locaux et en circuit court, au juste prix pour une clientèle consciente de l’impact écologique de sa consommation. Pour permettre d’aller au bout de la démarche, l’épicerie s’est dotée d’un outil de lavage professionnel afin de proposer un service de bouteilles consignées.
Bien loin de la maximisation des profits que l’on rencontre habituellement en économie linéaire, l’enjeu ici est de valoriser la réduction des déchets à la source et d’alimenter une chaîne de valeur vertueuse pour l’environnement. Des bénéfices difficilement quantifiables, mais qui ont une incidence pratique dans notre quotidien : « on gaspille moins et l’on sort moins la poubelle ». Ainsi, en consommant dans cette épicerie on va :
Réduire : Le vrac, c’est acheter la juste quantité pour réduire le gaspillage alimentaire, acheter au juste prix, réduire ses déchets ménagers.
Réutiliser les contenants : Les clients peuvent apporter leurs propres contenants et ainsi augmenter la durée de vie des ressources. Les bouteilles consignées sont partagées : privilégier l’utilisation sur la possession.
Refuser : En limitant l’approvisionnement pour certains produits à des zones de production locales et régionales, l’épicerie dirige la demande vers des produits transformés ou créés le moins loin possible, quitte à ne pas la satisfaire (fruits et légumes locaux et de saison, valorisation des artisans locaux).
L’épicerie en chiffres
Magasin de 60 m2, ouvert 8h par jour, 5j par semaine.
Trois salariés: Laura et Thomas à plein temps, une salariée en alternance 3j par semaine.
900 produits de tout type, provenant de 100 fournisseurs.
Entre 40 et 50 clients par jour pour un panier d’environ 15 euros.
Plus 3000 bouteilles consignées en circulation, nettoyées et remises en circulation sur place.
30% des clients font leurs courses entièrement avec leurs contenants et consignes.
Réduction des déchets d’emballage au niveau local pour 50 personnes par jour.
Description des paramètres économiques et financiers
Lors du montage en 2015, Boomerang a obtenu deux prêts d’honneur de la part d’Initiative Terre d’Azur (taux 0%, 8000 € chacun). Un financement participatif KissKissBankBank (177 personnes pour un montant de 7700 €) a permis à l’épicerie de s’équiper d’un outil de lavage de bouteilles.
Sur 3 ans, on observe une croissance de 10% du chiffre d’affaires par an. 35% du chiffre d’affaire est généré par des produits locaux (rayon de 250 km).
En outre, Boomerang est un acteur de l’ESS à différents titres:
Au niveau des fournisseurs : relocalisation de l’économie avec le concours des artisans locaux avec lesquels l’épicerie échange les contenants, des entreprises d’insertion pour les légumes, les fruits, la confection de biscuits…, des associations. Ils s’appuient sur la bonne volonté des producteurs et associations qui font l’effort de modifier leur mode de distribution en faveur du Zéro Déchet.
Au niveau de l’emploi : l’épicerie accueille en partenariat avec la Mission locale et Les Jardins de la Vallée de la Siagne, centre d’insertion par le travail, des stagiaires en difficulté. Le but pour eux est d’expérimenter une mise en situation de travail pour reprendre confiance dans le monde du travail. L’épicerie a accueilli plus de 10 stagiaires, dont l’une a été recrutée en alternance vente en milieu rural, afin de contribuer au développement de l’épicerie.
Les bénéficiaires de l’épicerie Boomerang dépassent ceux d’un commerce conventionnel pour englober l’ensemble des acteurs de l’écosystème dans lequel s’inscrit l’épicerie : outre les porteurs de projets, les clients, les fournisseurs, ils incluent les collectivités locales qui bénéficient de la réduction des déchets.
Description des paramètres juridiques
L’épicerie boomerang est une SARL créée en octobre 2015 sous le nom commercial Vrac Lab.
Description du mode de gouvernance
« Le projet est dirigé par Thomas et Laura, les créateurs. Ils pilotent Boomerang à partir de tout ce qui vient, la prise de décisions est nourrie par tous les apports des réseaux, clients, fournisseurs, partenaires qui interviennent directement dans le processus opérationnel du magasin (conseils, partage, envie,…).
Le projet ne consiste donc pas seulement en l’évitement des déchets mais en une réflexion beaucoup plus large sur la notion de l’essentiel. Il s’agit de faire du magasin un lieu de convivialité, d’expérience sensorielle et d’accompagnement, ce qui n’est pas présent dans d’autres magasins de vrac. Il y a aussi une recherche systématique, quand cela est possible, de partenariat étroit avec les fournisseurs locaux, dans une logique réciprocitaire.
Le magasin est un lieu d’échange et d’expression. Par l’implication des clients, la pédagogie va dans les deux sens, le magasin est un lieu de convivialité et d’échanges permanents.
Le projet génère des envies de contribuer par le bénévolat, mais il existe une difficulté à aller plus loin dans l’implication d’autres acteurs dans la gouvernance (à cause du statut SARL). Il y a des pistes d’améliorations, par exemple, accepter la participation de bénévoles lors de manifestations. »
Extrait remanié de l’expertise ESS réalisé par Geneviève Fontaine, T.E.T.R.I.S.
Temporalités du montage
2014 : Sourcing des producteurs et contact avec les associations locales
Fin 2015 : Création de la SARL Vrac Lab, obtention des deux prêts d’honneur, succès du financement participatif qui permet à l’épicerie de s’équiper d’un outil professionnel de lavage de bouteilles consignées
Janvier 2016 : Ouverture de l’épicerie après presque un an et demi de préparation
Septembre 2016 : Certification Agriculture Biologique par Qualisud
Octobre 2016 : Début de la vente ambulante zéro déchet en mobilité douce avec le vélo-vrac lors de manifestations ponctuelles
Mars 2017 : Mise en place d’un jardin partagé de quartier avec les habitants, les associations et les commerçants
Mai 2017 : Organisation du 1er festival zéro déchet avec la participation d’associations du territoire pour sensibiliser le grand public sur cette thématique
Description des paramètres humains
Au niveau des clients: développement d’un mode de distribution qui élimine à la source les déchets. Les clients participent à la mécanique en ramenant les bouteilles consignées, en se servant eux-mêmes, en faisant l’effort de penser à tarer chaque contenant : ils sont consom’acteurs. Ils affluent et échangent au sein du projet, le font évoluer (suggestions de produits…). Si Thomas et Laura sont les fondateurs de l’épicerie Boomerang, ce sont les clients les réels acteurs d’une consommation alimentaire plus responsable, qui chaque jour agissent concrètement pour un mode de vie raisonné et participent activement à la maîtrise de leur empreinte environnementale.
Au niveau des réseaux: Boomerang agit comme activateur de réseau, en établissant des liens de confiance avec ses partenaires. Ces relations basées sur la confiance permettent l’échange de conseils, des coups de main. Au sein du Réseau Vrac, la solidarité est très forte et très présente (recherche de fournisseurs). EcoScience Provence a fourni le support technique pour le procédé de lavage et d’embouteillage pour la consigne.
Épicerie Boomerang à Mouans-Sartoux, 04 93 12 10 22, http://www.boomerang.bio/